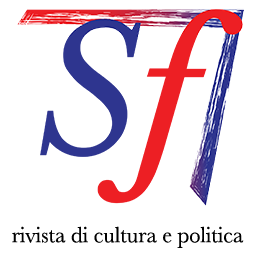Nel proporre il celebre capitolo sui cannibali, su popolazioni dell’attuale Brasile che a torto – a dire di Montaigne (1533-1592) – erano chiamate barbare, non si può non ricordare il severo giudizio di Todorov (Nous et les autres, Seuil, 1989, p. 70).
«Devant l’Autre, Montaigne est incontestablement mû par un élan généreux: plutôt que de le mépriser, il l’admire; et il ne se lasse pas de critiquer sa propre société. Mais l’autre trouve-t-il son compte dans ce manège? On peut en douter».
E ancora: «Le jugement de valeur positif est fondé sur le malentendu, la projection sur l’autre d’une image de soi – ou, plus exactement, d’un idéal du moi, incarné pour Montaigne par la civilisation classique. L’autre n’est en fait jamais perçu ni connu. Ce dont Montaigne fait l’éloge, ce ne sont pas des ‘cannibales’ mais de ses propres valeur».
È impossibile sapere come o cosa avrebbe risposto il grande umanista. Una ragione in più per rileggerlo.
Michel de Montaigne
da Des Cannibales (Essais, cap. XXXI, 1580)
Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu’il eut reconnu l’ordonnance de l’armée que les Romains lui envoyaient au-devant : « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci (car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères), mais la disposition de cette armée que je vois, n’est aucunement barbare». Autant en dirent les Grecs de celle que Flaminius fit passer en leur pays et Philippe, voyant d’un tertre l’ordre et distribution du camp romain en son royaume, sous Publius Sulpicius Galba. Voilà comment il se faut garder de s’attarder aux opinions vulgaires, et les faut juger par la voix de la raison, non par la voix commune.
J’ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré dix ou douze ans en cet autre monde, qui a été découvert en notre siècle, en l’endroit où Villegagnon prit terre, qu’il surnomma la France Antarctique.
Cette découverte d’un pays infini semble être de considération. Je ne sais si je me puis répondre qu’il ne s’en fasse à l’avenir quelqu’autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en celle-ci. J’ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n’avons de capacité. Nous embrassons tout, mais n’étreignons que du vent. […]
Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage; comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire de la vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l’ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l’envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées à sans culture. Ce n’est pas raison que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions que nous l’avons du tout étouffée.
Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises, «Le lierre pousse mieux spontanément, l’arboulier croit plus beau dans les antres solitaires, et les oiseaux chantent plus doucement sans aucun art.»
Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et l’utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la fortune, ou par l’art; les plus grandes et plus belles, par l’une ou l’autre des deux premières; les moindres et imparfaites, par la dernière.
Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir reçu fort peu de leçon de l’esprit humain, et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abâtardies par les nôtres; mais c’est en telle pureté, qu’il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n’en soit venue plus tôt, du temps qu’il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l’aient eue; car il me semble que ce que nous voyons par expérience, en ces nations, surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l’âge doré et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d’hommes, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. ils n’ont pu imaginer une naïveté si pure et simple, comme nous la voyons par expérience; ni n’ont pu croire que notre société se peut maintenir avec si peu d’artifice et de soudure humaine.
C’est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n’y a aucune espèce de trafic; nulle connaissance de lettres; nulle science de nombres; nul nom de magistrat, ni de supériorité politique; nuls usages de service, de richesse ou de pauvreté; nuls contrats; nulles successions; nuls partages; nulles occupations qu’oisives; nul respect de parenté que commun; nuls vêtements; nulle agriculture; nul métal; nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l’avarice, l’envie, la détraction, le pardon, inouïes.
Combien trouverait-il la république qu’il a imaginée éloignée de cette perfection: «des hommes fraîchement formés par les dieux.»
«Voilà les premières règles que la Nature donna.»
Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée; de façon qu’à ce que m’ont dit mes témoins, il est rare d’y voir un homme malade; et m’ont assuré n’en y avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté, ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer, et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant, entre-deux, cent lieues ou environ d’étendue en large. Ils ont grande abondance de poissons et les mangent sans autre artifice que de les cuire, de chairs qui n’ont aucune ressemblance aux nôtres. Le premier qui y mena un cheval, quoiqu’il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d’horreur en cette assiette, qu’ils le tuèrent à coups de trait, avant que le pouvoir reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs, et capables de deux ou trois cents âmes, étoffés d’écorce de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l’un contre l’autre par le faîte, à la mode d’aucunes de nos granges, desquelles la couverture pend jusques à terre, et sert de flanc.
Ils ont du bois si dur qu’ils en coupent, et en font leurs épées et des grils à cuire leur viande.
Leurs lits sont d’un tissu de coton, suspendus contre le toit, comme ceux de nos navires, à chacun le sien; car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil, et mangent soudain après s’être levés, pour toute la journée; car ils ne font autre repas que celui-là.
Ils ne boivent pas lors, comme Suidas dit de quelques autres peuples d’Orient, qui buvaient hors du manger; ils boivent à plusieurs fois sur jour, et d’autant. Leur breuvage est fait de quelque racine, et est de la couleur de nos vins clairets. Ils ne le boivent que tiède; ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours; il a le goût un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l’estomac, et laxatif à ceux qui ne l’ont accoutumé; c’est une boisson très agréable à qui y est duit. Au lieu du pain, ils usent d’une certaine matière blanche, comme du coriandre, confit. J’en ai tâté : le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes à tout des arcs. Une partie des femmes s’amusent cependant à chauffer leur breuvage, qui est leur principal office. Il y a quelqu’un des vieillards qui, le matin, avant qu’ils se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée, en se promenant d’un bout à l’autre et redisant une même clause à plusieurs fois, jusques à ce qu’il ait achevé le tour (car ce sont bâtiments, qui ont bien cent pas de longueur). Il ne leur recommande que deux choses : la vaillance contre les ennemis et l’amitié à leurs femmes. Et ne faillent jamais de remarquer cette obligation, pour leur refrain, que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée.
Il se voit en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs épées et bracelets de bois de quoi ils couvrent leurs poignets aux combats, et des grandes cannes, ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soutiennent la cadence en leur danser. Ils sont ras partout, et se font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasoir que de bois ou de pierre. Ils croient les âmes éternelles, et celles qui ont bien mérité des dieux, être logées à l’endroit du ciel où le soleil se lève; les maudites, du côté de l’Occident.
Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes, qui se présentent bien rarement au peuple, ayant leur demeure aux montagnes. A leur arrivée, il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages (chaque grange, comme je l’ai décrite, fait un village, et sont environ à une lieue française l’une de l’autre). Ce prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leur devoir; mais toute leur science éthique ne contient que ces deux articles, de la résolution à la guerre et affection à leurs femmes. Celui-ci leur pronostique les choses à venir et les événements qu’ils doivent espérer de leurs entreprises, les achemine ou détourne de la guerre; mais c’est par tel si que, où il faut à bien deviner, et s’il leur advient autrement qu’il ne leur a prédit, il est haché en mille pièces s’ils l’attrapent, et condamné pour faux prophète. A cette cause, celui qui s’est une fois mécompté, on ne le voit plus.
C’est don de Dieu que la divination; voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d’en abuser.
Entre les Scythes, quand les devins avaient failli de rencontre, on les couchait, enforgés de pieds et de mains, sur des chariotes pleines de bruyère, tirées par des boeufs, en quoi on les faisait brûler. Ceux qui manient les choses sujettes à la conduite de l’humaine suffisance sont excusables d’y faire ce qu’ils peuvent.
Mais ces autres, qui nous viennent pipant des assurances d’une faculté extraordinaire qui est hors de notre connaissance, faut-il pas les punir de ce qu’ils ne maintiennent l’effet de leur promesse, et de la témérité de leur imposture ? Ils ont leurs guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n’ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois, apointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. C’est chose émerveillable que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang; car, de déroutes et d’effroi, ils ne savent que c’est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l’ennemi qu’il a tué, et l’attache à l’entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître, fait une grande assemblée de ses connaissants; il attache une corde à l’un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d’en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l’autre bras à tenir de même; et eux deux, en présence de toute l’assemblée, l’assomment à coups d’épée.
Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n’est pas, comme on pense, pour s’en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes; c’est pour représenter une extrême vengeance. Et qu’il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s’étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d’une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l’autre monde, comme ceux qui avaient sexué la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu’eux en toute sorte de malice, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu’elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci.
Je ne suis pas marri que nous remarquons l’horreur barbaresque qu’il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entré des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu’il est trépassé.
Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque; ont bien pensé qu’il n’y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fut pour notre besoin, et d’en tirer de la nourriture; comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d’autres personnes inutiles au combat. »Les Gascons, dit-on, s’étant servis de tels aliments, prolongèrent leur vie».
Et les médecins ne craignent pas de s’en servir à toute sorte d’usage pour notre santé; soit pour l’appliquer au-dedans ou au-dehors; mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires.
Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie.
Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d’excuse et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir; elle n’a autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de nouvelles terres, car ils jouissaient encore de cette liberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu’ils n’ont que faire d’agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu’autant que leurs nécessités naturelles leur ordonnent; tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s’entrappellent généralement, ceux de même âge, frères; enfants, ceux qui sont au-dessous; et les vieillards sont pères à tous les autres.
Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette possession de biens par indivis, sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir, et qu’ils emportent la victoire sur eux, l’acquêt du victorieux, c’est la gloire; et l’avantage d’être demeuré maître eu valeur et en vertu; car autrement ils n’ont que faire des biens des vaincus, et s’en retournent à leur pays, où ils n’ont faute d’aucune chose nécessaire, ni faute encore de cette grande partie, de savoir heureusement jouir de leur condition et s’en contenter. Autant en font ceux-ci à leur tour.
Ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et reconnaissance d’être vaincus; mais il ne s’en trouve pas un, en tout un siècle, qui n’aime mieux la mort que de relâcher, ni par contenance, ni de parole un seul point d’une grandeur de courage invincible; il ne s’en voit aucun qui n’aime mieux être tué et mangé, que de requérir seulement de ne l’être pas. Ils les traitent en toute liberté, et leur fournissent de toutes les commodités de quoi ils se peuvent aviser, afin que la vie leur soit d’autant plus chère; et les entretiennent communément des menaces de leur mort future, des tourments qu’ils y auront à souffrir, des apprêts qu’on dresse pour cet effet, du detranchement de leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela se fait pour cette seule fin d’arracher de leur bouche quelque parole molle ou rabaissée, ou de leur donner envie de s’enfuir, pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés, et d’avoir fait force à leur constance. Car aussi, à le bien prendre, c’est en ce seul point que consiste la vraie victoire: «Il n’y a de véritable victoire que celle qui force l’ennemi à s’avouer vaincu».
[…]
Pour revenir à notre histoire, il s’en faut tant que ces prisonniers se rendent, pour tout ce qu’on leur fait, qu’au rebours, pendant ces deux ou trois mois qu’on les garde, ils portent une contenance gaie; ils pressent leurs maîtres de se hâter de les mettre en cette épreuve; ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre des batailles perdues contre les leurs. J’ai une chanson faite par un prisonnier, où il y a ce trait : qu’ils viennent hardiment tous et s’assemblent pour dîner de lui; car ils mangeront quant et quant leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi d’aliment et de nourriture à son corps. “ Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous êtes; vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s’y tient encore : savourez-les bien, vous y trouverez le goût & votre propre chair.” Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourants, et qui représentent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant la moue.
De, vrai, ils ne cessent jusques au dernier soupir de les braver et défier de parole et de contenance. Sans mentir, au prix de nous, voilà des hommes bien sauvages; car, ou il faut qu’ils le soient bien à bon escient, ou que nous le soyons; il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. Les hommes y ont plusieurs femmes, et en ont d’autant plus grand nombre qu’ils sont en meilleure réputation de vaillance; c’est une beauté remarquable en leurs mariages, que la même jalousie que nos femmes ont pour nous empêcher de l’amitié et bienveillance d’autres femmes, les leurs l’ont toute pareille pour la leur acquérir. Etant plus soigneuses de l’honneur de leurs maris que de toute autre chose, elles cherchent et mettent leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu’elles peuvent, d’autant que c’est un témoignage de la vertu du mari.
Les nôtres crieront au miracle; ce ne l’est pas; c’est une vertu proprement matrimoniale; mais du plus haut étage. Et, en la Bible, Lia, Rachel, Sara et les femmes de Jacob fournirent leurs belles servantes à leurs maris; et Livie seconda les appétits d’Auguste, à son intérêt; et la femme du roi Dejotarus, Stratonique, prêta non seulement à l’usage de son mari, une fort belle jeune fille de chambre qui la servait, mais en nourrit soigneusement les enfants, et leur fit épaule à succéder aux états de leur père.
Et, afin qu’on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leur usance et par l’impression de l’autorité de leur ancienne coutume, sans discours et sans jugement, et pour avoir l’âme si stupide que de ne pouvoir prendre autre parti, il faut alléguer quelques traits de leur suffisance. Outre celui que je viens de réciter de l’une de leurs chansons guerrières, j’en ai une autre, amoureuse, qui commence en ce sens : “ Couleuvre, arrête-toi; arrête-toi, couleuvre, afin que ma soeur tire sur le patron de ta peinture la façon et l’ouvrage d’un riche cordon que je puisse donner à m’amie : ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. ” Ce premier couplet, c’est le refrain de la chanson.
Or j’ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n’y a rien de barbare en cette imagination, mais qu’elle est tout à fait anacréontique.
Leur langage, au demeurant, c’est un doux langage et qui a le son agréable, retirant aux terminaisons grecques.
Trois d’entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu’elle soit déjà avancée, bien misérables de s’être laissé piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles neuvième y était. Le Roi parla à eux longtemps; on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d’unie belle ville. Après cela, quelqu’un en demanda leur avis, et voulut savoir d’eux ce qu’ils y avaient trouvé de plus admirable; ils répondirent trois choses, d’où j’ai perdu la troisième, et en suis bien marri; mais j’en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu’ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vraisemblable qu’ils parlaient des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et qu’on ne choisisse plutôt quelqu’un d’entre eux pour commander; secondement (ils ont une façon de leur langage telle, qu’ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu’ils avaient aperçu qu’il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu’ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons.
Je parlai à l’un d’eux fort longtemps; mais j’avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n’en pus tirer guère de plaisir.
Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité qu’il avait parmi les siens (car c’était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi), il me dit que c’était marcher le premier à la guerre; de combien d’hommes il était suivi, il me montra une espace de lieu, pour signifier que c’était autant qu’il en pourrait en une telle espace, ce pouvait, être quatre ou cinq mille hommes; si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu’il lui en restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il pût passer bien à l’aise.
Tout cela ne va pas trop mal : mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses !
[*]Source :http://ens.perrinchassagne.net/cannibales.html, consulté le 10.10.2018. La langue est en partie modernisée]